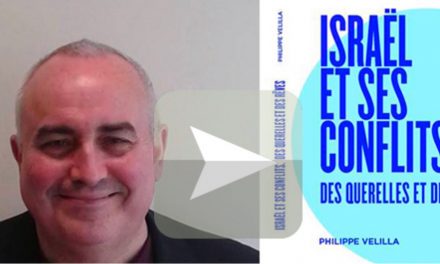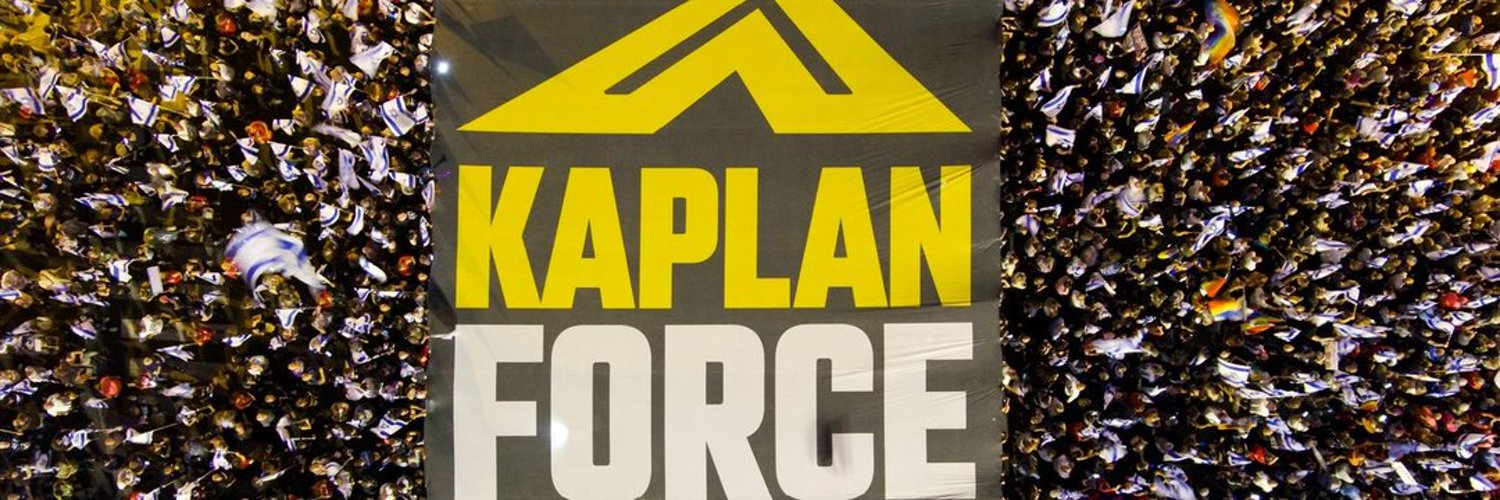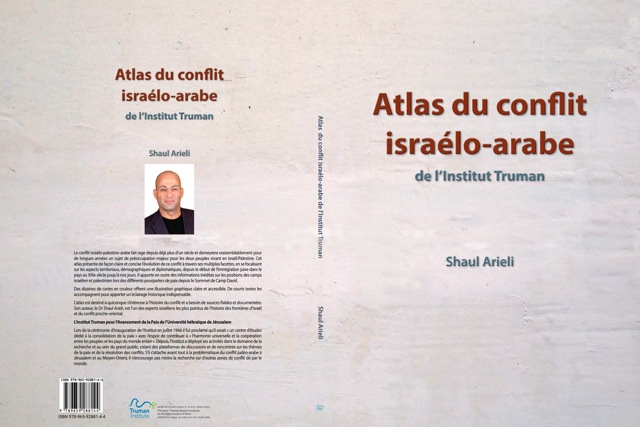Hier et avant-hier, la France et neuf autres États ont reconnu la Palestine. C’est une accélération significative hier. De très nombreux États reconnaissaient déjà la Palestine. Ils étaient 141 en février 2025 sur les 193 États membres de l’ONU.
Les 10 États supplémentaires qui s’y sont ajoutés hier et avant-hier sont des États de poids. Ainsi parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la majorité s’est inversée : à l’exception des États-Unis, tous, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, désormais reconnaissent la Palestine. Ceux qui prédisaient que l’initiative française ne serait pas ou peu suivie en sont pour leurs frais.
Mais de quoi s’agit-il en fait ? Cette reconnaissance n’est pas celle d’un État doté d’un territoire précis mais avant tout celle du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à un État indépendant, comme c’est le cas pour Israël. Elle ne présume pas des attributs de cet État, en particulier de ses frontières qui devront être définies dans le cadre de négociations et d’accords, de même que des autres questions essentielles, Jérusalem, réfugiés etc… Il s’agit donc d’une décision symbolique mais le peuple juif et Israël sont bien placés pour savoir l’importance du symbole et comment et combien il peut devenir un facteur et une force contribuant à modifier la réalité.
Précisons toutefois : si, dans sa reconnaissance de la Palestine, la France n’en définit pas les frontières précises, elle en donne les contours et ne peut en aucun cas être comprise comme « de la Mer au Jourdain » : l’État de Palestine est celui de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, aux côtés d’un Israël dont Macron trace également les contours, « de la Galilée à la Mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade, et par Jérusalem ». Retracer les frontières des deux États est l’enjeu d’un processus de paix à venir, pour tenir compte de la réalité démographique des colonies frontalières à la ligne de cessez-le-feu de 1949.
On sait que le gouvernement israélien mais aussi, il faut le reconnaître, une partie significative de la population, y compris celle qui proteste régulièrement contre la guerre et la coalition en place, sont opposés à cette reconnaissance, à sa temporalité d’abord. En guerre, non remise du traumatisme du 7 octobre, avec des otages qui agonisent dans les tunnels du Hamas, elle considère que ce n’est pas le moment et si ça l’était, pas sans conditions ni sans le retour des Israéliens vivants ou morts détenus à Gaza. On ne peut pas ne pas comprendre cette position sans pour autant devoir la partager.
Contrairement à ce qui est rabâché, cette reconnaissance n’est pas une récompense pour le Hamas. Le Hamas n’a jamais soutenu la solution à deux États et a toujours combattu l’existence d’Israël. Le Hamas est disqualifié dans cette initiative franco-saoudienne. Le pogrom du 7 octobre était intitulé « déluge d’Al -Aqsa » : appellation religieuse et non pas nationale ou politique. La pseudo réjouissance du Hamas à l’annonce de l’initiative française n’était que cynisme. La reconnaissance de la Palestine est une bonne chose pour le peuple palestinien, c’est évident, elle l’est tout autant pour Israël car elle peut enclencher une avancée vers un accord de résolution du conflit israélo-palestinien par la seule solution possible, autre que la Palestine de la rivière à la mer ou du grand Israël, à savoir la solution à deux États.
Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir renoncé aux conditions qui avaient été énoncées il y a quelques mois à savoir la démilitarisation du Hamas, sa non-participation dans l’État de Palestine, la réforme de l’Autorité palestinienne et la libération des otages ? Sans entrer dans la discussion de savoir s’il s’agissait de conditions préalables ou simultanées – dans la mesure où il était question non d’un geste isolé mais d’un projet global, incluant les axes de définition du « jour d’après »et de la reconstruction de Gaza dans un cadre régional – il est essentiel de tenir compte de ce qui a changé sur le terrain depuis juin 2025.
Outre le fait que le Hamas est resté fidèle à lui même, refusant la libération des otages, transformant la population civile en bouclier humain, responsable du déclenchement de la guerre et de sa continuation, Netanyahu est lui passé à un niveau supérieur dans sa soumission aux oukases des ses extrémistes, qu’il les subisse ou y adhère n’est pas pertinent ici : la guerre à Gaza dure pour sauvegarder sa coalition; lui éviter de prendre ses responsabilités dans la catastrophe du 7 octobre et surtout, dans la volonté de raser Gaza, se débarrasser de sa population, de prendre le contrôle total de la bande pour y établir des colonies et « faire de l’immobilier ».
Il ne faut pas omettre non plus l’accentuation de la colonisation en Cisjordanie, notamment sur le bloc E1, entre Jérusalem et Maale Adumim, une liberté et une impunité totale des colons dans leur violence à l’encontre des Palestiniens. Bref, le gouvernement a assumé son opposition ferme et résolue à une solution à deux États, à toute acceptation d’un État palestinien quel qu’il soit sans conditions aucunes. En fait, c’est le gouvernement israélien et sa politique menant le pays à une impasse, les Palestiniens à l’exode, qui ont rendu nécessaire et urgente la prise de mesures de sauvegarde de la possibilité d’une solution à venir à deux États.
Il est essentiel aussi de comprendre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas pour la diplomatie française. En se fixant des conditions sur lesquelles elle n’a aucune prise — la reddition du Hamas et la libération sans conditions des otages —, la France se condamne à ne pas reconnaître la Palestine. Or, par son initiative qui prend acte de l’échec d’Oslo et qui renverse le processus en accordant la reconnaissance au rang d’État au préalable, la France a su insuffler des avancées majeures du côté arabe : non seulement la reconnaissance d’Israël, mais le rejet du Hamas par la Ligue arabe et par l’Autorité palestinienne, fin de la rente aux familles des Palestiniens ayant commis des attaques contre des Israéliens, acceptation d’un statut démilitarisé, reconnaissance du droit à la sécurité d’Israël.
En reconnaissant aujourd’hui la Palestine et en laissant à demain le règlement négocié de toutes les questions en suspens, l’initiative franco-saoudienne met sous respiration artificielle la possibilité de l’avènement de la Palestine. En ce sens, elle est nécessaire maintenant, mais elle n’est pas à l’évidence suffisante. Elle ne met pas fin à la guerre, au drame des Gazaouis, à la libération des otages. Elle ne permet en elle-même ni la reconstruction de Gaza ni la réhabilitation d’Israël.
La reconnaissance de la Palestine ne peut dans le temps présent être soumise à condition, elle est la condition à toute solution d’avenir et à sa pérennité. Elle doit marquer un commencement, l’avènement d’une instance de pouvoir qui devra au plus vite confirmer les engagements inclus dans la lettre de Mahmoud Abbas à Emmanuel Macron le 10 juin 2025. Cette instance de pouvoir sera le partenaire avec lequel les États auront à échanger, négocier, établir ou rompre des relations diplomatiques selon que les engagements seront ou non respectés.
Bref, les reconnaissances de la Palestine des 21 et 22 septembre 2025 sont un commencement porteur d’espoir pour les Palestiniens même si ce n’est pas leur priorité actuelle : leur survie. Un commencement indispensable, un commencement dont l’aboutissement est loin d’être a pour autant assuré.
Nous serons aux côtés de ceux qui en Israël œuvrent sans relâche à la solution à deux États, encore possible, plus nécessaire que jamais, la seule à même de sortir les deux peuples du cycle infernal d’une guerre sans fin.