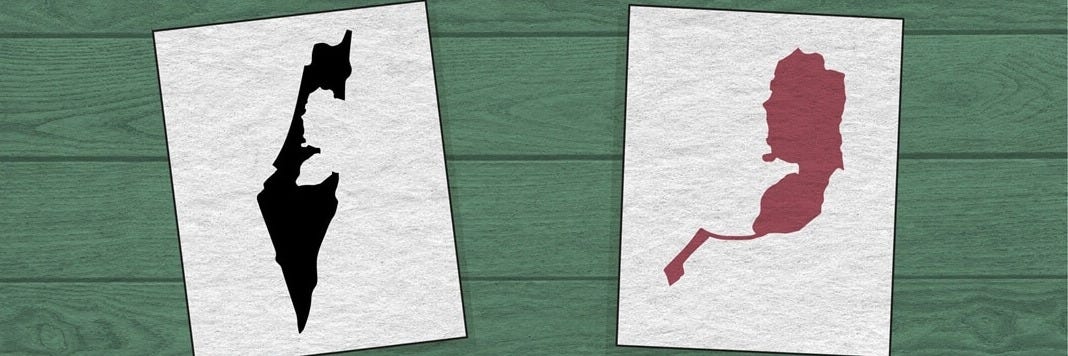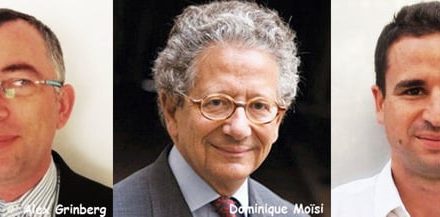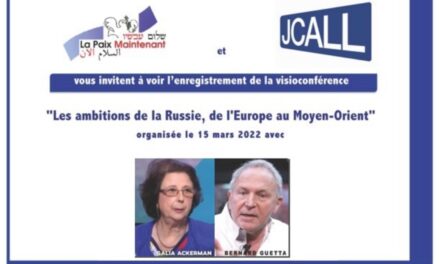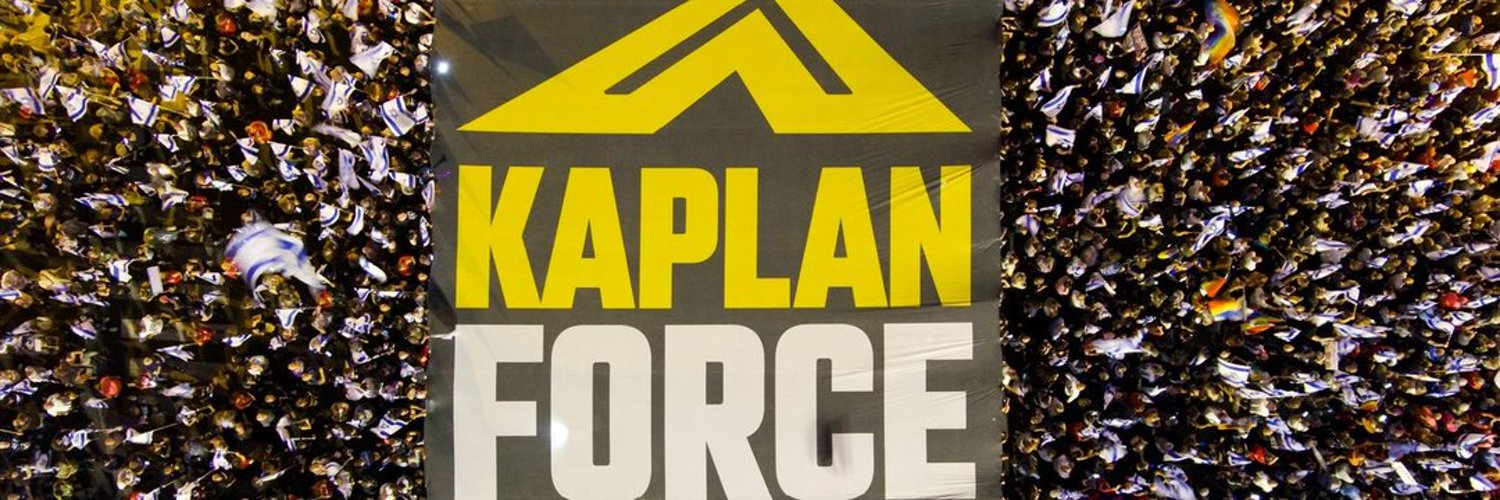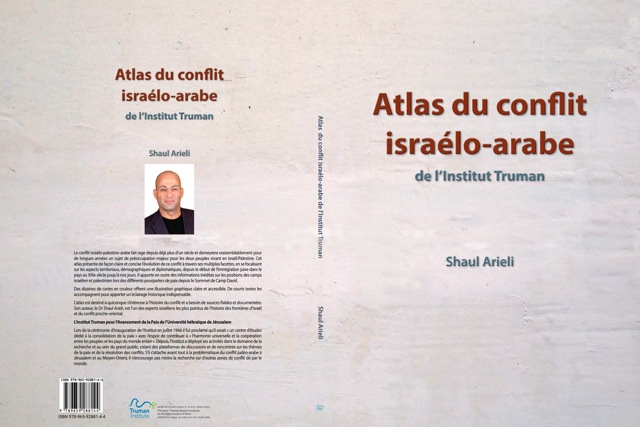« On me questionne fréquemment sur l’opinion publique en Israël et en Palestine, et plus particulièrement sur ce que pensent les habitants de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, ma réponse est la même : les sondages réalisés en temps de guerre n’ont aucune réelle pertinence pour appréhender l’opinion publique un an après le conflit. Je tiens à rappeler que tous les sondages ne sont qu’un instantané. Les sondages en temps de guerre reflètent un niveau d’émotion élevé et, dans notre cas, un traumatisme. On observe généralement un ralliement autour du drapeau et une acceptation quasi automatique du discours dominant véhiculé par les dirigeants et les medias.«
Auteur : Gershon Baskin, 19 novembre 2025
https://gershonbaskin.substack.com/p/polls-peace-and-partnership
Traduction : Deeple, revue par YM
Mis en ligne le 20 novembre 2025
Sondages, paix et partenariat
Je ne considère pas les sondages réalisés en temps de guerre comme particulièrement pertinents pour comprendre le potentiel à long terme des processus politiques. Comme tous mes lecteurs le savent, je n’ai jamais cessé de plaider en faveur de politiques qui nous mèneront à une véritable paix israélo-palestinienne. Pendant quelques années avant le 7 octobre, je me suis demandé si la solution à deux États était encore viable et j’ai donc entrepris plusieurs réflexions avec d’autres Palestiniens et Israéliens sur des alternatives. Peu après le 7 octobre, j’ai retrouvé la conviction qu’il n’y avait pas d’autre solution à notre conflit que la solution à deux États (qui peut prendre différentes formes) et qu’elle était de nouveau d’actualité, plus pertinente que jamais. Naturellement, j’ai été contesté par presque tous, des deux côtés, qui affirment que l’opinion publique israélienne et palestinienne est plus éloignée que jamais de la solution à deux États, ou de toute autre solution. Les sondages d’opinion actuels, de part et d’autre, reflètent très clairement cette réalité. Néanmoins, je reste convaincu que cette solution est plus pertinente que jamais et que nous n’avons jamais été aussi proches de l’atteindre. Les sondeurs, des deux camps, contribuent en réalité à figer le discours selon lequel les opinions publiques israélienne et palestinienne ne sont même pas prêtes à envisager la paix, et les Israéliens ne sont certainement pas prêts à envisager la création d’un État palestinien à côté d’Israël, pas plus que les Palestiniens ne sont disposés à accepter la légitimité de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique.
Cela reflète fidèlement la réalité façonnée par les sondages d’opinion et par ceux qui se prétendent leaders, mais qui ne sont en réalité que des suiveurs. Ces prétendus leaders suivent ce qu’ils perçoivent comme l’opinion publique, sans comprendre que le rôle du leadership est de façonner l’opinion publique, et non de la suivre passivement. Je suis toujours stupéfait de constater que les sondeurs posent les questions dont ils attendent les réponses, sans se demander si une question complémentaire pourrait modifier les résultats. Par exemple, lorsque des sondeurs palestiniens demandent aux Palestiniens s’ils soutiennent la lutte armée, ou la résistance armée, contre Israël, surtout en temps de guerre, les résultats avoisinent les 50 %, voire plus. J’ai demandé à Khalil Shikaki, l’un des principaux sondeurs palestiniens : « Pourquoi ne posez-vous pas la question suivante ? » Il m’a demandé : « Quelle est la question suivante ? » J’ai répondu : « Êtes-vous prêt à prendre les armes et à combattre les Israéliens ? Êtes-vous prêt à envoyer votre fils prendre les armes pour combattre les Israéliens ? » Il m’a répondu (de façon insatisfaisante à mon avis) : « Nous ne sommes pas prêts à mettre nos participants humains en danger. » Les sondages étant totalement anonymes, j’ignore de quel risque il parlait. Mais je suis presque certain que s’il avait posé la question, le nombre de réponses aurait chuté à un niveau proche de zéro.
Les sondeurs israéliens et palestiniens posent toutes sortes de questions sur le soutien à diverses solutions au conflit. Il est clair que les deux opinions publiques sont encore très loin d’envisager un soutien à quelque solution que ce soit. Les nettes majorités qui se dégageaient autrefois de part et d’autre en faveur de la solution à deux États ont disparu au cours des deux dernières décennies de violence et face à l’absence totale de toute direction politique visant à nous guider vers une solution pacifique au conflit. Mon expérience personnelle, non scientifique, acquise en discutant avec des milliers d’Israéliens et de Palestiniens au cours des 20 dernières années, depuis la seconde Intifada en 2000, m’a permis de constater qu’un grand nombre de personnes, des deux côtés, utilisent exactement les mêmes mots pour exprimer leur position : « Je veux la paix, mais eux, non. » Cette affirmation reflète en substance la réalité vécue par nos deux peuples depuis l’échec du processus de paix et les violences de la seconde Intifada. Le mythe du « non-partenaire », né de l’échec de Camp David en juillet 2000, s’est solidement ancré, chaque camp prouvant à l’autre qu’il n’était pas un partenaire pour la paix. Qu’il s’agisse du soutien palestinien aux attentats-suicides en Israël, du nombre très élevé de morts perpétrés par Tsahal durant la seconde Intifada et depuis, de l’expansion constante des colonies israéliennes et de la confiscation des terres palestiniennes, ou encore du soutien de l’opinion publique palestinienne aux atrocités du Hamas le 7 octobre, les exemples de l’absence de véritables partenaires pour la paix, tant en Israël qu’en Palestine, ne manquent pas.
En 2005, j’ai mené une étude d’opinion publique du côté israélien afin de comprendre ce qui pourrait convaincre les Israéliens que les Palestiniens étaient des partenaires pour la paix. Cette question nous intéressait car des recherches antérieures avaient montré que si les Israéliens croyaient que les Palestiniens étaient véritablement prêts à vivre en paix, une majorité d’entre eux seraient disposés à accepter les concessions nécessaires à la réussite d’une solution à deux États. Nous avons réalisé des sondages classiques et mené cinq discussions de groupe approfondies. Les résultats ont été remarquables : les réponses des cinq groupes (certains homogènes, incluant des personnes religieuses, et d’autres hétérogènes) étaient identiques. À l’époque (et je pense que les réponses actuelles seraient très similaires), les Israéliens ont déclaré que si les Palestiniens enseignaient la paix dans les écoles (en modifiant les programmes et les manuels scolaires) et si les imams des mosquées de toute la Palestine prêchaient la paix, alors ils croiraient que les Palestiniens étaient véritablement prêts à vivre en paix aux côtés de l’État d’Israël. Je crois que la plupart des Israéliens souhaiteraient également entendre de la part des Palestiniens que le peuple juif entretient un lien religieux et national légitime avec la Terre d’Israël.
Nous n’avons pas mené d’étude aussi approfondie du côté palestinien, mais si nous devions la réaliser aujourd’hui, je pense que les Palestiniens témoigneraient de leur conviction que les Israéliens sont des partenaires pour la paix s’ils constataient une politique de gel de toute construction de colonies, et plus encore si Israël décidait de démanteler environ 130 avant-postes construits ces deux dernières années. Il est également important que les Palestiniens entendent de la part d’Israël la reconnaissance, ne serait-ce que de principe, du droit à l’auto-détermination du peuple palestinien et l’acceptation de l’idée d’un État palestinien. La question des prisonniers est cruciale pour chaque citoyen palestinien. Si les dirigeants israéliens annonçaient que, dans le cadre d’un véritable accord de paix mettant fin à l’occupation, les prisonniers palestiniens acceptant cet accord bénéficieraient d’une amnistie (ce qui est généralement le cas lors de la résolution de conflits), ils seraient plus enclins à croire en la sincérité de leur soutien.
Nous, Israéliens et Palestiniens, avons besoin de voir des manifestations concrètes de partenariat entre les citoyens israéliens et palestiniens, ainsi que de la part de ceux qui se prétendent dirigeants. Nos deux sociétés entreront bientôt en période électorale. Il est donc absolument crucial que les dirigeants comprennent que leurs déclarations publiques ne sont pas seulement perçues par leurs électeurs potentiels ; les populations de l’autre côté du conflit les écoutent également attentivement pour savoir à quoi s’attendre et s’y préparer. Si un message positif de paix se propageait d’un camp à l’autre, cela aurait sans aucun doute un impact positif sur l’électorat adverse. La question est de savoir si les dirigeants israéliens et palestiniens potentiels sont conscients de leur capacité à influencer le résultat des élections de l’autre côté.
Les dirigeants israéliens qui évoquent la paix avec les Palestiniens risquent-ils de perdre des voix ou, au contraire, d’en gagner ? Je suis certain que les conseillers politiques des candidats leur recommanderont de ne pas aborder ce sujet. J’ai été témoin et acteur de cette dynamique en 2015, lorsque j’ai initié et facilité des négociations officieuses entre Yitzhak Herzog, alors chef du Parti travailliste, et le président Mahmoud Abbas. Chacun avait désigné un représentant. Pour convaincre Herzog de s’engager dans ce processus, je lui ai expliqué que s’il parvenait à un accord avec Abbas, il pourrait annoncer publiquement des élections sur la base de cet accord, qui instaurerait la paix israélo-palestinienne. Trois semaines avant les élections, alors qu’Herzog était en tête des sondages, je l’ai appelé de Ramallah, depuis le domicile du représentant palestinien du président Abbas, et lui ai annoncé qu’Abbas était disposé à organiser une conférence de presse conjointe pour annoncer la conclusion de l’accord. Suivant les conseils de ses stratèges, il m’a dit de dire au président Abbas de se taire, et on connaît la suite. Je suis convaincu que si Herzog avait révélé publiquement qu’il détenait un accord de paix potentiel, il aurait remporté ces élections – mais ce ne sont là, bien sûr, que des conjectures.
Je suis convaincu que si nos dirigeants, ou ceux qui aspirent à le devenir, n’évoquent pas une paix véritable avec l’autre partie, nous n’aurons pas de dirigeants capables de nous guider vers la paix. Ils doivent cependant être conscients que le contexte international et régional actuel est plus favorable que jamais aux discussions sur la paix israélo-palestinienne. L’existence d’un président américain qui a démontré avoir le pouvoir et la volonté de contraindre Israël à mettre fin à la guerre et à respecter la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l’auto-détermination et à la création d’un État palestinien devrait nous faire comprendre que, lorsque la situation sur le terrain s’améliorera, Trump sera disposé à user de son influence pour nous rapprocher de la solution à deux États. Le désir des pays arabes de la région de voir émerger cette solution et leur volonté d’étendre les accords d’Abraham en établissant des relations diplomatiques complètes avec Israël devraient être un signe positif pour l’opinion publique israélienne : la paix est réellement possible, si Israël est prêt à accepter la solution à deux États. De plus, il est généralement admis que la paix israélo-palestinienne n’est plus un processus bilatéral, mais un processus régional multilatéral garantissant une architecture régionale pour la sécurité et le développement économique. Une paix israélo-palestinienne fondée sur la solution à deux États améliorera la sécurité et l’économie de toute la région et devrait également donner aux Israéliens l’assurance que le moment est venu de faire la paix.
Le peuple palestinien doit comprendre qu’après Gaza en particulier, il n’y a pas de lutte armée viable pour libérer la Palestine. Les Palestiniens n’obtiendront pas un État en tuant des Israéliens. Ils n’obtiendront pas un État en rejetant le lien légitime du peuple juif avec la Terre d’Israël. Les dirigeants palestiniens, ou ceux qui aspirent à le devenir, doivent également comprendre que c’est le peuple israélien, et non seulement l’opinion publique palestinienne, qui les écoute lorsqu’ils s’expriment. Ils doivent aussi avoir le courage et la clairvoyance de savoir que la réalisation de la promesse de liberté pour les Palestiniens passe par Jérusalem, Tel-Aviv et l’ensemble d’Israël, et non seulement par les capitales d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord.
Nous, Israéliens et Palestiniens, devons comprendre qu’il est désormais impératif de toucher le cœur et l’esprit des personnes de l’autre côté de ce conflit. À ceux qui me demandent « Comment puis-je aider ? », je conseille de trouver quelqu’un de l’autre camp et de lui demander : « Parlez-moi de vous. Qui êtes-vous ? Pourquoi croyez-vous en ce que vous croyez ? Quelle est votre histoire ? » Je dis : « N’argumentez pas, écoutez. Vous aurez vous aussi l’occasion de raconter votre histoire. Mais essayez de comprendre votre interlocuteur. Il ne s’agit pas de déterminer qui a raison et qui a tort, mais de tenter de comprendre la personne de l’autre côté du conflit. J’admets que ce n’est pas facile et que la tentation de répondre et de marquer des points est forte. Mais essayez de le faire sans répondre systématiquement à chaque point avec lequel vous êtes en désaccord. Rien ne garantit un résultat positif, mais il existe une possibilité. Plus nous pourrons témoigner d’un véritable partenariat pour la paix, même au niveau personnel, plus grandes seront les chances de succès de la construction de la paix.
Enfin, commencez à apprendre et à parler la langue de l’autre personne. C’est le meilleur moyen d’ouvrir son cœur et, lorsque vous apprendrez sa langue et sa culture par un désir sincère de comprendre son monde, vous vous engagerez sur la voie de nouvelles découvertes qui vous ouvriront les yeux et vous permettront d’imaginer une nouvelle réalité. »