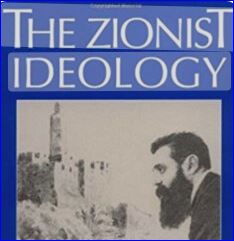Le mouvement sioniste, qui avait pour but le retour et la création d’un État-nation juif en Terre d’Israël/Palestine, a dû faire face à une objection de taille depuis ses débuts: celle de la présence arabe sur ce territoire. Comment peut-on justifier le retour des Juifs sur une terre déjà habitée par un autre peuple, et ce, sans son consentement? C’est ce que le monde entier reproche au sionisme.
De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent régler ce dilemme en invoquant l’antériorité du peuple juif (l’argument de l’ancien propriétaire) lui conférant un droit historique immuable. D’autres sont plutôt tentés d’invoquer un droit biblique. Ces arguments se sont renforcés depuis 1967, afin de justifier l’expansionnisme israélien dans les territoires conquis en 1967.
Or, nous dit Gideon Shimoni, dans ce texte tiré de son opuscule, « The Zionist Ideology » (1995), les fondateurs d’Israël, de gauche comme de droite, savaient que ces arguments étaient difficilement recevables du point de vue de la morale universelle. Devant le reste du monde, ils cherchaient plutôt à ancrer la légitimité du sionisme sur la base d’arguments universalistes.
Document pour la 27e réunion annuelle de l’AIS, 13-15 juin 2011, soumis par le Professeur Émérite Gideon Shimoni, Université hébraïque de Jérusalem.
Traduction : Catherine Kammer-Mayer et Bernard Bohbot pour LPM
https://www.academia.edu/38091044/The_Discourse_on_Right_to_the_Land_of_Israel_in_Zionism_and_Israel
Mis en ligne le 6 avril 2022
L’objectif de cet article est d’examiner de manière analytique l’historique des formulations sionistes du droit présomptif juif à la terre d’Israël, et de comparer cet historique du discours à la formulation actuellement prédominante dans la conscience publique israélienne.
Le mouvement sioniste, dans toute sa diversité idéologique, a permis d’énoncer une gamme de revendications sur la terre d’Israël. Dans mon livre The Zionist Ideology, j’ai tenté d’expliquer de manière exhaustive l’ensemble des justifications sionistes qui furent formulées. Ici, dans cet article nécessairement plus bref, j’utiliserai un paradigme simple afin de définir l’ultime dénominateur commun de toutes les formulations sionistes : imaginez théoriquement la réflexion d’un juge objectif et impartial, après qu’il eut entendu tous les arguments pertinents – religieux, historiques, juridiques – présentés par les porte-paroles officiels des parties arabe et juive.
Tout d’abord, le juge doit clarifier l’enjeu dont il est question. S’agit-il des droits de l’homme et du citoyen ? La réponse est négative. En effet, chacune des parties a fait part de sa volonté d’accorder tous les droits civiques et humains à l’ensemble des citoyens de l’État qu’elle revendique comme son foyer national. Compte tenu de cette assurance, il devient évident que l’enjeu est essentiellement national. En d’autres termes, le groupe ethnique juif, représenté par son mouvement nationaliste auto-proclamé, le sionisme, revendique le droit collectif du peuple juif de faire de cette terre qu’ils appellent Eretz Israël un cadre étatique destiné à répondre aux besoins spécifiques, matériels et culturels, des Juifs, et plus généralement à offrir l’auto-détermination et l’épanouissement de la nation. Parallèlement, le groupe ethnique arabe, représenté par son entité nationaliste arabe palestinienne, revendique le droit collectif de la population arabe domiciliée sur le territoire qu’il appelle Filastin, de constituer ce territoire comme son propre État national, conjointement avec d’autres États arabes qui assurent l’auto-détermination nationale de l’ensemble de la nation arabe.
Dans ces conditions, notre juge théorique devrait délibérer en tenant compte de ces facteurs : la revendication religieuse est totalement subjective et donc inacceptable ; une revendication subjective de la foi ne peut passer pour un droit légitime. Quant aux soi-disant « droits historiques », il s’agit en fait de revendications fondées sur des preuves historiques de liens physiques et culturels. Celles-ci établissent très certainement la pertinence de la revendication juive, mais ne sont certainement pas concluantes, car les Arabes disposent de liens historiques avec ce territoire qui sont tout aussi pertinents. De la même façon, les revendications en termes de droit international ne sont pas concluantes. Conclusion : il s’agit d’un conflit entre deux revendications tout aussi justifiable l’une que l’autre. Il n’existe aucune solution conforme à l’équité absolue.
Il est donc nécessaire d’adopter une approche purement éthique du jugement. Dans ces circonstances, notre juge théorique pourrait appliquer le principe éthique utilitaire. En termes simples, il s’agit d’arriver à une décision qui ferait le maximum de bien et le minimum de mal (« bien » signifiant ne pas faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas qu’il nous fasse). Le juge réfléchit donc : supposons que je me prononce en faveur de la revendication nationale juive, quel bien aurais-je fait ? Certainement un bien immense pour les Juifs depuis longtemps victimes de persécutions, qui ont un besoin urgent de mettre fin à des siècles d’existence sans patrie ! Mais quel mal pour les Arabes ? Il est certain qu’une blessure grave et une privation relative seraient infligées aux Arabes palestiniens. Dans un monde parfait, cette portion du monde arabe devrait avoir son propre État national, tout comme les autres peuples Arabes du Moyen-Orient qui possèdent des États indépendants, comme la Syrie ou l’Irak, par exemple. Le segment national palestinien, seul parmi tous les peuples arabes (qui se définissent comme une Umma panarabe), devrait alors accepter le statut de groupe de population jouissant de tous les droits civiques ainsi que d’un degré raisonnable d’autonomie nationale et culturelle, mais à titre de minorité seulement.
Le juge se demande maintenant : supposons que ma décision penche en faveur de la revendication nationale arabe, quel bien aurais-je fait ? On peut certainement parler d’un bien immense, qui apporterait aux Arabes de Palestine la même mesure d’auto-détermination nationale que celle dont jouissent toutes les autres branches de la nation panarabe. Dans un monde parfait, il ne fait aucun doute que c’est cela qui devrait être fait. Mais quel mal cela ferait-il aux Juifs ? C’est là que le bât blesse ; cela n’engendrerait pas seulement une « blessure et une privation relative” pour les Juifs, mais un coup mortel, car il n’y a absolument aucune autre possibilité ou endroit dans le monde où les Juifs peuvent exercer leur droit à l’auto-détermination nationale.
Pour résumer la signification du paradigme : en analyse finale, et sur la base du principe d’une plus grande nécessité existentielle et d’un principe éthique utilitaire, la revendication nationale juive vis-à-vis d’Eretz Israël a priorité sur la revendication nationale arabe vis-à-vis de Filastin. Une précision s’impose : la revendication sioniste a une préséance relative, pas nécessairement un droit exclusif et absolu.
Il ne faut pas croire que ce paradigme est une pure abstraction, détachée de la réalité historique. Les archives font état d’une pléthore de citations tirées des déclarations des principaux dirigeants sionistes, toutes tendances politiques confondues. Prenons, par exemple, les paroles de Vladimir Jabotinsky, le leader principal de la droite sioniste, qui s’adressait à la Commission Peel de 1936-7, nommée par le gouvernement britannique pour examiner en profondeur la nature du conflit judéo-arabe.
Dans ce discours, Jabotinsky affirmait : « Quand la revendication arabe est confrontée à notre demande juive d’être sauvés, c’est comme confronter les revendications de l’appétit contre les revendications de la famine ». [Emphase ajoutée] Aucun tribunal n’a jamais eu la chance de juger une affaire où toute la justice était du côté d’une partie et où l’autre partie n’avait aucun argument en sa faveur. Habituellement, dans les affaires humaines, tout tribunal, y compris celui-ci, en jugeant deux causes, doit concéder que les deux parties ont des arguments de leur côté et, afin de rendre justice, il se doit de prendre en considération ce qui devrait constituer la justification de base de toutes les demandes humaines, individuelles ou collectives – le terrible équilibre décisif du besoin. [1]«
Passons de l’autre côté du spectre politique, au leader sioniste de la gauche travailliste, David Ben-Gourion. On peut citer son témoignage devant la Commission des Nations Unies sur la Palestine de 1947 : « La conscience de l’humanité devrait peser ceci : « où est la balance de la justice, où est le plus grand besoin, où est le plus grand péril, où est le moindre mal et où est la moindre injustice ? »[2]
Pour citer un autre exemple : Chaim Weizmann, président de l’Organisation sioniste mondiale, disait à la Commission d’enquête anglo-américaine de 1946 : » Il n’y a pas de solution parfaite ni de justice absolue dans ce monde. Ce que vous essayez de faire, et ce que nous essayons tous de faire à notre petite échelle, n’est qu’une justice humaine relative. Je pense que la décision que je voudrais que ce comité prenne, si j’ose dire, serait d’approcher la marque de l’injustice la moins grande... »[3]
Cette formulation du droit juif à faire d’Eretz Israël un État juif était le dénominateur commun consensuel de l’idéologie sioniste, qui peut être illustré par de nombreux autres exemples dans tout l’éventail des groupes politiques sionistes, y compris évidemment les principaux défenseurs de ce que l’on pourrait appeler le « camp du compromis pour la paix », tels que Judah Magnes et Martin Buber, qui préconisaient des solutions binationales pour Eretz Israël/Filastin. Selon les termes de Buber, ce camp considérait comme « un point fondamental le fait que, dans ce cas, deux revendications vitales sont opposées l’une à l’autre, deux revendications de nature et d’origine différentes, qui ne peuvent être opposées l’une à l’autre et entre lesquelles aucune décision objective ne peut être prise quant à celle qui est juste ou injuste. »[4]
Rien n’est plus révélateur du statut consensuel de cette formulation – du moins pendant les années qui ont précédé la Guerre des Six Jours – que le fait que l’on puisse trouver la même justification dans le camp sioniste orthodoxe national-religieux. En effet, elle constitue la base de ce qui est peut-être l’ouvrage moral-légal publié sur le sujet le plus profondément argumenté de la période précédant l’État d’Israël. Il s’agit d’un livre en hébreu publié en 1933 sous le titre « Notre droit historique-légal à Eretz Israël« . Son auteur était Reuven Gafni (Weinshenker), une personnalité active du parti Hapoel-Hamizrahi du sionisme orthodoxe-religieux. Gafni soutenait que l’équité internationale, tout comme l’équité intra-nationale, exigeait l’application de principes moraux universellement acceptés tels que « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse », ou l’impératif catégorique de Kant selon lequel les actions d’une personne doivent être d’une nature telle que l’on souhaiterait qu’elles soient la règle universelle [5].
Il convient de noter que c’est à ce moment-là que l’idée de compromis par le biais de la partition est entrée dans le débat idéologique, d’abord en 1937 et finalement en 1947. L’essence de la position sioniste consensuelle était la suivante : en premier lieu, la revendication nationale juive a une préséance morale relative sur la revendication arabe. C’est d’autant plus vrai si, dans un deuxième temps, une solution de partition devait également fournir une mesure d’épanouissement national arabe palestinien dans un État voisin coexistant pacifiquement avec l’État juif.
Dans l’arène internationale, c’était la formulation consensuelle du droit juif à la terre. Cela ne veut pas dire que dans l’histoire du mouvement sioniste jusqu’à la création de l’État d’Israël, aucun groupe sioniste n’a défendu le principe rigide selon lequel le peuple juif a le droit exclusif et absolu de posséder la terre d’Israël dans son intégralité. Mais cela ne caractérisait que la minorité de droite radicale du sionisme révisionniste, illustrée par le minuscule et éphémère groupe Brit Habiryonim à la fin des années 1920 en Palestine, et le plus important groupe militant clandestin Lehi dans les années 1940. Cette revendication repose sur la conviction fasciste que la force l’emporte toujours ; par conséquent, la realpolitik donne aux Juifs le droit de déplacer ou de dominer les « étrangers » non-juifs qui avaient spolié les propriétaires légitimes d’Eretz Israël et l’avaient occupé pendant les siècles d’exil juif forcé (galut).
Après la création de l’État juif
Nous pouvons maintenant nous demander : qu’est-ce qui a changé au cours du dernier demi-siècle ? Dans le courant politique israélien actuel, quel est le discours dominant concernant le droit à la terre ? Par “courant politique actuel”, j’entends les principaux partis politiques, en laissant de côté les extrémistes radicaux en marge, à savoir, d’une part, les Juifs antisionistes ou les soi-disant post-sionistes partisans d’un État unique désionisé regroupant tous les citoyens et, d’autre part, les néo-kahanistes partisans de l’expulsion des Arabes palestiniens ou de divers projets d’autonomie partielle destinés à perpétuer leur statut civique de subordination.
Il est manifestement évident que le discours dominant dans le discours public d’aujourd’hui est tout simplement le principe fondamentaliste – la promesse de Dieu de donner la terre au peuple juif à perpétuité, comme en témoigne la Bible. Les graines de cette conception n’ont pas été plantées dans le sionisme d’avant l’État, mais seulement après la Guerre des Six Jours, principalement par les idéologues de Gush Emunim et les successeurs de ce mouvement au sein du Conseil représentatif de Judée, Samarie et Gaza, communément appelé Yosh. Jusqu’à ce jour, leur source d’autorité et d’inspiration la plus importante reste le regretté Rabbi Zvi Yehuda Kook (fils du premier grand rabbin ashkénaze de Palestine, Avraham Yitzhak Hakohen Kook), qui dirigeait la Yeshiva Rav Kook à Jérusalem. Peu après la Guerre des Six Jours de 1967, il a imprimé de manière dogmatique le principe halakhique suivant : « La Terre [d’Israël] dans son intégralité est absolument nôtre et aucune partie ne doit être donnée à d’autres, c’est « un héritage de nos ancêtres ». » (Avoda Zara נ « ג עבודה זרה) et que la Torah proscrit absolument toute « renonciation irrévocable d’un territoire en faveur d’une nation étrangère. »[6]
Sans entrer dans une analyse historique entièrement documentée, on peut facilement identifier les facteurs qui ont produit la notion de prévalence consensuelle dans la manière particulière dont les Israéliens conçoivent le droit à la terre, bien que le poids relatif de chaque facteur soit sujet à débat. Ces facteurs comprennent la transformation du sionisme national-religieux opérée par le mouvement Gush Emunim et son influence religieuse et politique phénoménale sur le segment conservateur-faucon de l’échiquier politique israélien, qui a lui-même connu une ascension depuis la fin des années 1970, lorsque Menahem Begin est devenu Premier ministre. Cette ascension a atteint son plus haut sommet dans le gouvernement actuel. À ce facteur s’ajoute l’influence naturelle non seulement du pouvoir exercé par l’occupation militaire, mais aussi des intérêts humains qui encouragent l’autojustification de la part de la population toujours croissante des colons, y compris le développement urbain qui favorise la cooptation idéologique des segments ultra-orthodoxes et laïques de la population.
Bien sûr, en outre, ces facteurs internes ont largement réagi à l’hostilité palestinienne toujours aussi irréductible, largement exacerbée par le contrôle du Hamas, dont le rejet absolu d’Israël, fondé sur la foi, alimente un fanatisme incomparablement plus brutal que le rejet des revendications palestiniennes, fondé lui aussi sur la foi, du Gush Emunim. À ces facteurs, il faut ajouter les échecs répétés et les impasses qui ont ponctué le soi-disant « processus de paix » qui piétine, en particulier les résultats indéniablement contre-productifs du retrait unilatéral du Premier ministre Ariel Sharon de la bande de Gaza. L’effet combiné de tous ces facteurs a établi une conviction primordiale de la realpolitik, selon laquelle les Juifs d’Israël sont confrontés à une situation de survie à somme nulle.
Quels que soient les facteurs qui expliquent, de manière plus ou moins claire, la prévalence de cette situation à somme nulle au sein de l’opinion publique juive, la réalité est qu’elle s’est enracinée idéologiquement – ou, pourrait-on dire, qu’elle a trouvé un refuge idéologique – dans la formulation absolue fondée sur la foi qui a émané de l’idéologie du Gush Emunim et de ses successeurs dans le Conseil de Judée et Samarie. On croit avec une foi zélée et on argumente avec une éloquence considérable et une incontestabilité supposée que, par droit divin absolu, la terre d’Israël dans son intégralité appartient exclusivement à la nation juive.
De plus, on soutient que cela est vrai à perpétuité, même si l’on reconnaît que des circonstances historiques indépendantes de la volonté des Juifs ont rendu nécessaire l’abandon de certaines parties de la Terre – comme l’exclusion de la Transjordanie en 1921, et aussi de la Cisjordanie après la guerre de 1948. Par conséquent, si des circonstances nouvelles ont rétabli le contrôle national juif sur ces parties de la Terre d’Israël – comme cela s’est produit après la Guerre des Six Jours de 1967 – les Juifs ont pleinement le droit de réaffirmer leur droit exclusif. De même, on considère que si les Arabes domiciliés en Terre d’Israël jouissent de droits civiques égaux, ce n’est pas en vertu d’un droit équivalent au droit absolu du peuple juif, mais plutôt comme une simple concession bienveillante accordée en vertu des valeurs démocratiques inhérentes au sionisme et qui définissent Israël comme un État non seulement « juif » mais aussi « démocratique ».
Il découle de ces mêmes prémisses confessionnelles que l’exercice du droit juif à Hébron et à tout autre site en Samarie et en Judée n’est pas différent du droit juif à des sites tels que Tel Aviv et Petach Tikva. Sur cette base, Yosef Ben-Shlomo, un professeur de philosophie et intellectuel aguerri, qui est devenu l’un des principaux penseurs du mouvement des colons dans les territoires occupés après 1967, pouvait justifier l’implantation de Yosh en premier lieu, non pas par des considérations de sécurité à somme nulle, mais avec insistance sur des bases éthiques. Il a fait valoir que la possession et l’installation à Yosh sont la base même du droit moral juif à la terre. Nier la validité éthique de Yosh revient à nier la validité éthique de l’État d’Israël lui-même. Qualifier Yosh de « territoire occupé » revient à qualifier l’État d’Israël de territoire occupé. Qualifier de colonialistes des colonies en territoire occupé comme Ofra ou Efrat revient ipso facto à qualifier de colonialistes Tel Aviv et tous les sites en Israël à proprement parler. Dans la mesure où ce déni éthique est basé sur l’accusation de colonialisme (le colonialisme, Ben-Shlomo en convient, n’est plus acceptable à la fin du 20e siècle), cela revient à dire ipso facto qu’Israël lui-même est une entreprise coloniale, donc non éthique. Selon Ben-Shlomo, « …le principe moral n’a pas de lignes, verte ou autres. Le colonialisme s’applique à tout endroit où un peuple étranger dirige des territoires occupés dans une terre qui n’est pas la sienne, ce qui doit inclure Sheykh Munis (Ramat Aviv), Katamon et Baq’a à Jérusalem, Ashdod et Ramla – sans parler des terres sur lesquelles reposent soixante-quinze kibboutzim Hashomer Hatza’ir. »[7] Par conséquent, dit Ben-Shlomo, il n’y a absolument aucune différence entre le droit des Juifs à la colonisation et à la souveraineté au-delà de la soi-disant Ligne verte à Yosh, et leur droit de vivre dans l’État juif souverain d’Israël. En somme, seule l’affirmation d’un droit divin et donc absolu sur la Terre d’Israël rend l’existence d’Israël moralement défendable !
Le pur sophisme de cet argument est stupéfiant, tout comme la non-reconnaissance aveugle de la différence éthique entre la colonisation dans le contexte du mandat ottoman et britannique en Palestine et la colonisation dans le contexte du règne et de la suppression conséquente d’une majorité indigène ayant un statut civique subordonné. Pourtant, ce sophisme a été imprimé dans la conscience de la majorité des Juifs israéliens et, tous les signes le montrent, également chez une majorité de Juifs religieux orthodoxes de la Diaspora.
Ce n’est pas le fait de croire qu’il y a un Dieu qui a promis la Terre au peuple juif qui est en cause ici. C’est la croyance authentique à laquelle tous les adeptes du judaïsme orthodoxe doivent adhérer. Ce qui est en cause, c’est l’interprétation fondamentaliste de cette croyance qui lui confère une validité absolue et, de là, sa transfiguration politique de « prétention » subjective à « droit » objectif. D’où le caractère du débat exégétique au sein du camp orthodoxe ; c’est-à-dire entre, d’une part, les rabbins de la majeure partie des sionistes nationaux-religieux et, d’autre part, une minorité rationaliste de juifs sionistes orthodoxes qui ont formé au fil des ans des associations telles que Netivot Shalom, Oz Ve -Shalom et le parti politique Meimad. Ce débat exégétique a tourné autour du commentaire de Rachi sur la Genèse (1,1)[8]. Ainsi, le professeur Uriel Simon, l’un des principaux porte-paroles de ce segment du sionisme national-religieux, a soutenu que le Midrash de Rachi ne constitue en aucun cas une interprétation exclusive ou valide. Il le montre en proposant l’interprétation du Rambam du même verset, selon laquelle le livre de la Genèse dans son intégralité « est destiné à nous enseigner le principe selon lequel notre emprise sur la Terre est conditionnée à notre obéissance à la parole de Dieu »[9].
Au sein du camp national-religieux, cette seule voix minoritaire est compatible avec la justification qui fut historiquement consensuelle du droit à la terre sur la base éthique utilitaire du besoin existentiel, à laquelle seul le secteur libéral du public religieux séculier et non-orthodoxe d’Israël reste fidèle. Celui qui a articulé de la façon la plus éloquente ce point de vue est le célèbre écrivain Amos Oz. À plusieurs reprises, Amos Oz a utilisé l’analogie d’un homme en train de se noyer qui ne peut sauver sa vie que s’il s’agrippe à la planche sur laquelle un autre survivant du naufrage a déjà trouvé refuge. Il soutient que « l’entreprise sioniste n’a pas d’autre justification objective que le droit d’un homme qui se noie à saisir la seule planche qui peut le sauver. Et c’est une justification suffisante. Mais, ajoute-t-il : « Il y a une grande différence morale entre le naufragé qui saisit une planche et s’y fait une place, et celui qui repousse les autres rescapés à la mer. C’est l’argument moral qui sous-tend notre accord de principe répété sur le partage de la terre. C’est la différence entre la judaïsation de Jaffa et Nazareth et la judaïsation de Ramallah et Naplouse [10].
Mais il ne fait guère de doute que cette compréhension du droit à la terre a été marginalisée dans l’Israël contemporain. Ce n’est que dans des cercles déclinants de l’intelligentsia, principalement des écrivains, des journalistes et des universitaires, que l’on trouve une articulation aussi raffinée de la conception libérale et moralement conditionnelle du droit juif à la terre sur la base d’un besoin et d’un droit existentiel historiquement démontrable. L’amère vérité est la suivante: aujourd’hui, on repousse l’autre à la mer.
Notes
[1] Vladimir Jabotinsky, Evidence Submitted to the Palestine Royal Commission, (pamphlet), Londres 1937, pp. 10-29.
[2] « Evidence of David Ben-Gurion, » The Jewish Plan for Palestine: Memoranda and Statements Presented by the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Special Committee on Palestine, Jerusalem, 1947, pp. 324, 325.
[3] « Testimony to the Anglo-American Committee, August 3rd 1946, » The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series B: Papers, vol. 2, ed. Barnet Litvinoff, Jerusalem, 1984, pp. 594-595.
[4] Voir Shimoni, The Zionist Ideology, pp. 345-350; 372-378.
[5] Reuven Gafni, Zekhutenu ha-historit-mishpatit al Eretz Israel, (Our Historical-Legal Right to Eretz Israel), Jerusalem, 1933. Cela n’a été publié que quelques années avant que la question de la partition n’apparaisse au premier plan. Avocat de profession, Gafni a présenté le cas juif principalement en référence à la promesse divine. Il a souligné le lien historique objectif entre le peuple juif et Eretz Israël, a présenté la cause de l’autodétermination juive du point de vue du droit international et a expliqué le « droit moral » objectif des Juifs à Eretz Israël indépendamment de la croyance en la promesse divine.
[6] Zvi Yehuda Kook, Torah Loyalty and The Land, » Whose Homeland: Eretz Israel Roots of the Jewish Claim, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem, n.d., c. 1980, p. 184. Voir idem, Le-netivot Israel, Jerusalem, Rav Kook Institute, 1967 [en hébreu]
[7] Yosef Ben-Shlomo, « The Beginning of the End? » Policy Paper No. 54, Ariel Center for Policy Research (ACPR) tiré du livre Israel and the Palestinisn State: Zero Sum Game?, 2001
[8] Voir le commentaire de Rachi faisant autorité sur Genèse 1,1, dans lequel il déclare : « Si les nations du monde remettent en cause la validité du titre d’Israël sur la Terre sainte en disant : « Vous êtes des voleurs, car vous avez envahi les territoires des sept peuples », [qui occupaient la Terre auparavant] Israël peut rétorquer : « Le monde entier appartient au Seigneur. Il l’a créé et l’a donné à qui Il a jugé bon. C’était Sa volonté de le donner à eux [les nations cananéennes] et c’était Sa volonté de le leur enlever pour nous le donner. »
[9] Il explique : Cananéens (Lévitique, XVIII : 28). « … » Le Maître de l’univers a prévu la Terre d’Israël pour le peuple d’Israël, mais seulement en conjonction avec l’avertissement sévère que notre véritable emprise sur la Terre dépend de notre comportement… Il s’ensuit qu’il nous est commandé non seulement de croire en la souveraineté du Créateur, mais aussi de veiller à ce que la réalisation de notre droit à la terre soit compatible avec la vérité et la justice. » Uriel Simon, « Religion, Morality and Politics, » in Religious Zionism: Challenges and Choices, Oz Veshalom Publications, (n.d., circa 1980). pp.22-23
[10] Voir Amos Oz, Under this Blazing Light: Essays,(trs. Nicholas de Lange), Cambridge, 1995, Idem, Help Us to Divorce: Israel and Palestine between Right and Right, Vintage, London, 2004. Voir aussi Amos Oz, « The meaning of Homeland », tel que réimprimé dans Who Is Left: Zionism Answers Back, The Zionist Library, Jerusalem 1971. Pratiquement la même justification du droit juif à la terre d’Israël est expliquée par A.B. Yehoshua. Voir A.B. Yehoshua, Between Right and Right, (trs. Arnold Schwartz) New York, 1981.